Un dérèglement climatique majeur nous pend au nez, et rien n’est fait pour l’enrayer. Selon Sébastien Bohler, docteur en neurosciences, le responsable serait notre cerveau, accro à la dopamine depuis des millions d’années. Mais bonne nouvelle : on peut le rééduquer !
Nous sommes face à une urgence climatique et notre réaction n’est pas à la hauteur du problème. Comment l’expliquez-vous ?
C’est en partie lié au fonctionnement de notre cerveau, et à nos cinq instincts fondamentaux : manger, se reproduire, gagner du prestige (du statut social), trouver de l’information et faire le moins d’effort possible. À chaque fois qu’on les satisfait, on a du plaisir. On sait aujourd’hui traduire ce mécanisme physiologiquement : notre striatum nous envoie une dose de dopamine [sorte d’« hormone du plaisir », qui permet la communication au sein du système nerveux, NDLR]. Ce mécanisme est en place depuis le paléolithique et a contribué à la survie de l’espèce humaine. Un peu plus tard, s’est développé le cortex. Il a favorisé le développement des technologies, de l’agriculture intensive, l’élevage en batterie, les pesticides, engrais, OGM… Nous avons donc un système qui, au départ, était configuré pour manger le plus possible dans un environnement hostile, mais qui n’a jamais été programmé pour s’arrêter, s’autolimiter. Résultat : on mange sans limites et les courbes de l’obésité s’envolent partout dans le monde ; on meurt aujourd’hui plus du surpoids que de la faim.
Si trouver de l’information est une fonction de base, pourquoi ne réagit-on pas en conséquence au dérèglement climatique ?
Ce qui nous manque, c’est la capacité à percevoir cette menace au niveau émotionnel. C’est toujours lié au striatum, qui lance des processus émotionnels puissants, notamment avec la dopamine. Il réagit aux situations présentes. On le voit avec des expériences très simples. Si l’on nous propose d’avoir 10 euros tout de suite ou 20 euros dans un an, systématiquement, on choisit ce qui se passe maintenant. C’est un réflexe enfoui au plus profond de notre cerveau. Donc on doit faire un effort intellectuel pour visualiser la hausse des températures, du niveau des océans, la sécheresse, l’effondrement de la biodiversité. Notre striatum est totalement imperméable à des échéances de dix, vingt, trente ans.
On commence à subir les effets du dérèglement climatique, comme lors des épisodes caniculaires. Est-ce un facteur pour réagir ?
Effectivement, on ne réagit que quand les catastrophes se produisent. Mais en ce moment, on est dans un entre-deux. Nous avons des coups de semonce, qui durent une, deux semaines, puis ça va un peu mieux. Donc on va s’alarmer pendant une, deux semaines et, en même temps, imaginer qu’il y a moyen de s’en sortir ; on va, par exemple, installer des climatisations. Cette publicité d’une compagnie aérienne française pour « 1 million de sièges à 40 € » pendant la canicule de juin 2019 montre le cynisme, l’incohérence de notre société : « Plus la température grimpe, plus les prix baissent […]. Les sièges sont bien au frais mais à ce prix-là, ils fondent comme neige au soleil… » En résumé, on a encore moyen de se faire plaisir quand ça va mal. Il y a une faillite de la raison. Les sondages de mai 2019 montraient la soi-disant prise de conscience pour les enjeux écologiques, or celle-ci s’efface totalement au moment d’acheter des billets d’avion pour partir en vacances. On met entre parenthèses notre conscience pour satisfaire l’excitation de notre striatum qui veut nous donner un plaisir tout de suite.
Nous avons tous un striatum, or les peuples racines, par exemple, ne sont pas aliénés par cette folle course à la croissance…
Notre striatum est aussi façonné par le système social dans lequel on vit. Il est motivé par le statut social, la valorisation. Si vous êtes valorisé sur la base de votre salaire, la taille de votre voiture, votre smartphone ou les marques que vous portez, vous allez chercher ces signes extérieurs de richesse. C’est le modèle social occidental, où la valorisation sociale de l’individu est liée à l’argent. Chez les peuples racines, elle passe probablement par d’autres voies. Des études d’anthropologie ont décrit des peuples en Amazonie où l’individu dans le clan était valorisé non par ce qu’il possédait, mais par ce qu’il donnait 1. Plus vous donnez, plus vous êtes valorisé. C’est également ce qui ressort des études d’imagerie cérébrale comparant les hommes et les femmes. Elles montrent, par exemple, que les petites filles à qui l’on apprend à partager vont avoir du statut social associé au fait de donner 2. Donc c’est quelque chose qu’on peut voir à la fois chez les peuples racines et chez des petites filles qu’on éduque au fait avoir de l’empathie et de la sollicitude.
L’éducation joue donc un rôle fondamental.
Oui, fondamental.

Peut-on déjouer le fonctionnement du striatum ? Le cortex peut-il gagner le match ?
Le cortex est très développé aujourd’hui, mais on l’utilise uniquement pour l’intelligence pratique. On devrait l’utiliser pour développer notre conscience. Parce que la conscience peut inter-agir avec notre striatum, pour ajouter une dimension qualitative au plaisir biochimique qu’il nous donne. L’autre problème du striatum est qu’il est programmé pour obtenir toujours plus. Les réseaux sociaux ont bien intégré ce principe. Quand on gagne des likes sur Facebook, le striatum libère de la dopamine. Le problème, c’est que si le nombre de likes stagne, la dopamine s’épuise. Le striatum dit alors : « Si c’est comme ça, j’arrête de donner de la dopamine. » Idem quand vous mangez sucré : vous avez un shoot de dopamine machinal, vous en prenez toujours plus et finalement, il n’y a plus de dimension qualitative. Alors que si vous instaurez de la conscience, en prenant le temps de détailler les saveurs, la finesse, la texture, de laisser la satiété s’installer, eh bien ! avec une quantité moindre, vous aurez autant de plaisir et de dopamine ! Mais créer cette conscience demande un effort du cortex. La méditation est un outil formidable pour cela.
À part la méditation, avons-nous d’autres outils pour arriver à ce même résultat ?
La patience. Je reprends l’exemple de l’alimentation avec la fameuse expérience du marshmallow 3 : on donne le choix à un enfant d’avaler une friandise tout de suite ou d’attendre et d’en avoir deux. C’est très difficile, il a envie de l’avaler maintenant. Mais par l’éducation, inciter les enfants à attendre, ne pas céder à leurs impulsions, c’est ça qui va leur donner la capacité de ne pas être dans l’urgence du plaisir, mais dans la patience du plaisir. Un plaisir-passion, c’est un plaisir qui peut se mettre entre parenthèses, qui peut se contenter de quantités moindres. Des expériences similaires 4 existent avec l’addiction aux réseaux sociaux chez les adolescents. On arrive à muscler la patience. Et l’on voit même sur les IRM que les liaisons entre le cortex et le striatum peuvent être modifiées. La liaison cortex/striatum est un muscle qui peut se rééduquer, se renforcer. Finalement, il nous redonne une forme de liberté. Car si vous faites instantanément ce que votre dopamine vous incite à faire, où est la liberté ? Il n’y en a plus ! Par contre, la force de résister, la volonté nous redonnent notre liberté.
Cela laisse la responsabilité à l’individu, alors qu’il y a aussi une dimension politique…
Oui, ce moteur physiologique génétique est une donnée défavorable. On a été programmés pendant des millions d’années pour satisfaire ces besoins fondamentaux. On a favorisé un monde, un système économique, politique, qui ne fait que satisfaire ces cinq besoins primitifs, au sens « préhistoriques ». Aujourd’hui, ça nous emmène dans le mur. Dès lors, la question est : quel environnement social crée-t-on avec cette donnée ?
Le choix était-il conscient ou inconscient ?
Sûrement un peu des deux, mais il y a une partie délibérée. Si l’on prend, par exemple, les analyses qui ont été faites dans les années 1920 5. Au moment où l’économie américaine a commencé à s’essouffler, où les grandes entreprises automobiles, d’électroménager ont eu du mal à écouler les stocks. Il y a eu une réflexion pour faire en sorte que les gens aient envie de choses dont ils n’avaient pas besoin. C’est le rapport de l’administration Hoover qui préconisait de faire jouer le statut social : avoir plus que le voisin. Encore aujourd’hui, si vous regardez les publicités pour l’automobile, les constructeurs font exactement ce qu’ils ont compris depuis les années 1920 : flatter le besoin de comparaison sociale. Où intervenir sur les libertés individuelles, la liberté de communiquer, la liberté d’expression, la liberté d’entreprise ?
Comment répondre à ces questions ?
On a besoin de sens, de quelque chose qui relie les gens à très large échelle. Il nous faut des valeurs fondatrices, des valeurs « sacrées », qui priment sur toutes les autres, auxquelles tout le monde adhère. L’enjeu est de remettre de la coopération et, disons-le, du sacrifice, mais dans l’équité. Sans personne qui s’échappe, se dédouane de ses obligations ou vive avec des privilèges.
« Sacrifice », est-ce audible ?
Audible ou pas, de toute façon, on n’a pas le choix. Si l’on veut avoir une chance que la planète soit habitable dans son temps, il va falloir que l’on fasse des sacrifices. On en est capables si on les fait tous ensemble. Et c’est là que se pose la question du modèle plutôt compétitif ou plutôt collaboratif. Nous devons mettre en place un projet, une organisation sociale où chacun soit content de faire des sacrifices, soit pour une cause, avec du sens, sachant que les autres le font aussi. Quand les hommes, les femmes construisaient des cathédrales en mangeant un quignon de pain et en vivant trente ans seulement, c’était plus que des sacrifices, mais ils étaient persuadés que cela avait un sens qui allait au-delà de leur existence sur terre. On ne peut plus faire ce pari-là, on n’est plus dans le mysticisme. Mais cela montre que si l’on fait quelque chose collectivement pour un objectif qui a un sens, alors on est capable de soulever des montagnes.
Certes, mais notre société favorise l’individualisme. Comment se rééduquer à la coopération ?
C’est une question de confiance. L’être humain est capable de coopérer, faire des sacrifices et renoncer à beaucoup de choses, à condition que les autres le fassent aussi. C’est une constante dans les études d’anthropologie. La coopération chez l’être humain est conditionnelle. Si vous demandez à un adolescent préoccupé par le climat : « Est-ce que tu veux bien renoncer à tes baskets de marque ? », il répond : « Je veux bien, mais je ne veux pas être le seul. » Dans un groupe, si vous êtes le seul à ne pas avoir de signes de statut social, c’est insupportable. On a besoin de se sentir sur un pied d’égalité avec les autres. Donc coopérer, c’est indispensable, mais il faut des structures, des dispositifs sociaux ou institutionnels, qui assurent que les autres font leur part aussi. Car depuis les origines, on a une voix double dans le cerveau. Il y a ce striatum qui nous fait rechercher des avantages personnels alors que notre survie passe par le groupe. L’éclosion des technologies, la révolution industrielle nous ont mis dans une situation où l’on s’est dit : « Je n’ai plus besoin des autres. » Aujourd’hui, on peut vivre seul dans notre coin avec notre télécommande, notre voiture. On a quitté la voie de la coopération, mais on est obligés de la rejoindre. Une clé serait de donner du statut social, mais avec de nouvelles stimulations. Cela ne doit plus être consommer, produire, mais, par exemple, arroser une plante, donner de l’argent à quelqu’un qui en a besoin : des gestes plus tournés vers l’autre que vers soi. Quand on donne aux autres, on obtient de la dopamine et on se fait du bien. Les grands altruistes ont un striatum très puissant.
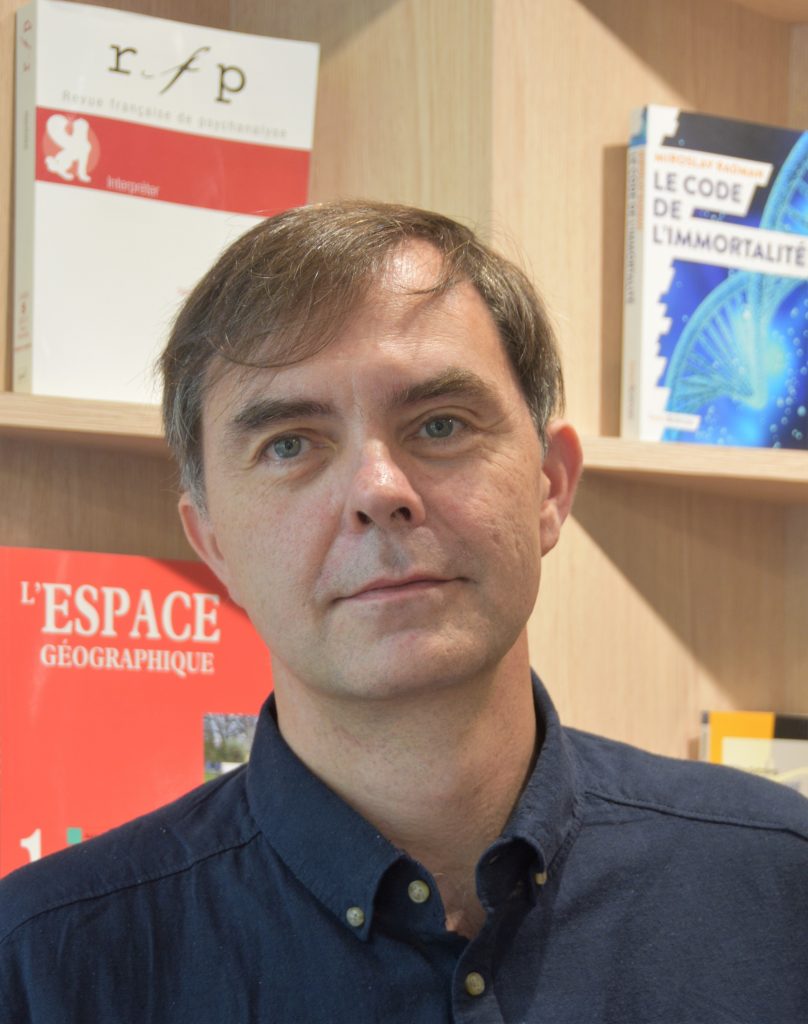
Pourquoi l’altruisme ne fonctionne-t-il pas dans la société alors qu’on le vit en famille ?
Parce que notre contrat social, qui réunit des millions de personnes, est basé sur la concurrence. C’est le meilleur qui s’en sortira. Or l’altruisme demande de déplacer la logique de l’instantané vers le temps long, ce qui est bruyant vers le silencieux, la concentration ; cela demande des efforts.
L’individualisme, n’est-ce pas in fine un déni de notre propre mort ? De notre finitude ?
Oui. En psychologie, quand on incite les gens à penser à leur propre mort, un des grands schémas de réaction consiste à consommer encore plus, pour éloigner le spectre de la mort. Pour se dire : « Je suis toujours dans le bien-être, dans le plaisir. » Sans aller jusqu’à l’idée de sa propre mort, le divertissement évite de se poser, de chercher du sens, de prendre le temps de se dire : « Mais finalement, où est-ce que je veux aller ? » Ces questionnements sont insupportables. Ils impliquent de tout remettre en cause : votre travail, votre couple, votre mode de vie, où vous habitez… C’est trop angoissant. Trop de chantiers en perspective… et à ce moment-là, on se dit : « Il y a un programme sympa à la télé… »
C’est un manque de spiritualité ?
Un vide de sens, en tout cas. On a basculé dans le « tout-consommation » grâce à un mouvement d’appropriation sur la nature par la science, la technologie qui a évacué la spiritualité. Aujourd’hui, on a tellement tout rempli de pouvoir matériel et de confort qu’on n’a presque plus de sens. Donc on regarde nos objectifs de vie en se disant : « J’aimerais réussir dans mon boulot, mettre mes enfants dans cette école-là, avoir une plus grande maison… », c’est sympa, ça nous fait avancer. Oui… et après ? Où est le sens ? Apparemment, pour un nombre croissant de nos citoyens, avec les bullshit jobs, etc., cela devient difficile individuellement. Il y a une demande croissante de sens.
N’y a-t-il pas une fonction de dissonance cognitive chez les politiques ? Élevés à la croissance, ne serait-ce pas trop dur pour eux de dire : « On a échoué, il faut aller vers la décroissance, la sobriété heureuse. » ?
Certainement, oui. Ce n’est pas simple d’admettre que tout votre système d’interprétation et votre système d’action ne sont pas valables… On le voit dans le domaine de l’entreprise, dans toutes les situations où l’on sait qu’il y a des projets voués à l’échec, mais on les poursuit quand même. C’est une question d’ego, la plupart du temps. Donc, d’une part, vous n’avez pas d’autres schémas de pensée par lequel remplacer celui que vous laissez. Et d’autre part, vous avez votre ego qui est dans la balance. Je pense que c’est ingérable.
Quel est votre regard sur les collapsologues ?
La peur peut être un ressort dans certaines conditions. Quand elle débouche sur des solutions, qu’en même temps, on donne des pistes, des leviers d’action. Si vous faites juste peur aux gens sans leur donner de levier d’action, ça stagne. Typiquement, c’est l’exemple du fumeur : « Regarde, tu vas mourir si tu continues ! » « Bah ! non, je continue et regarde, tout va bien. » Mais si vous faites peur et que vous dites : « Bah ! je vais te donner l’adresse d’un tabacologue. Il y a ce médicament qui marche. Tu peux y arriver à condition d’être suivi. » Là, les gens prennent leur destin en main. Donc la peur ne suffit pas, mais parfois elle est nécessaire.
Quand on vit des moments difficiles, le stress génère la fuite, l’inhibition ou la colère. Savons-nous laquelle de ces trois réactions va prédominer face aux changements attendus ?
Notre réaction à la peur varie selon la proximité du danger. Si le danger est loin, c’est l’immobilisation. Vous êtes une proie et vous avez repéré un prédateur qui est loin ; en vous immobilisant, il y a des chances qu’il ne vous voie pas. S’il y a une distance intermédiaire, là, il faut fuir. Par contre, s’il est tout près, il faut se battre. Donc, on le voit à l’échelle de la société, on est dans une situation intermédiaire où la perception diffère d’une personne à une autre. Certains vont voir la menace comme proche. Et d’autres comme très éloignée, voire inexistante.
Propos recueillis par Pascal Greboval et Louna Boulay.
Entretien initialement publié dans Kaizen n°46, sept-oct 2019.
- Ricardo Godoy et al., « Signaling by Consumption in a Native Amazonian Society », in Evolution and Human Behavior, vol. 28, 2007.
- Alexander Soutschek et al., « The Dopaminergic Reward System Underpins Gender Differences in Social Preferences », Nature Human Behaviour, vol. 1, 2017.
- Walter Mischel, «Father-Absence and Delay of Gratification: Crosscultural Comparison», The Journal of Abnormal and Social Psychology, vol. 63, 1961.
- Simone Kühn et al., «The neural basis of video gaming», Translational Psychiatry, vol 1:e53, 2011.
- Jeremy Rifkin, La Fin du travail, La Découverte, 2006.
Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur : « L’eau est universelle, indispensable et unique »
J’ai beaucoup aimé cet article(merci). L’exemplaire papier stipule dans un encart en bas de page qu’on peut retrouver « la version longue et vidéo de cet entretien sur …cette page! mais je ne vois pas de vidéo… où puis-je trouver l’interview complète? Merci
Bonjour Jonathan et merci de votre retour !
Ceci est bien la version longue de notre interview avec Sébastien Bohler.
Les vidéos seront mises en ligne au fur et à mesure sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) !
Belle journée,
L’équipe de Kaizen